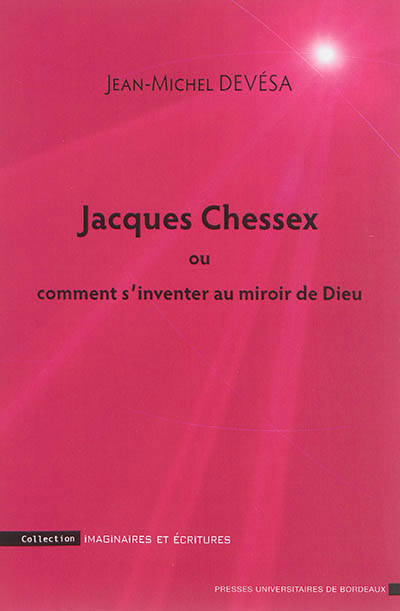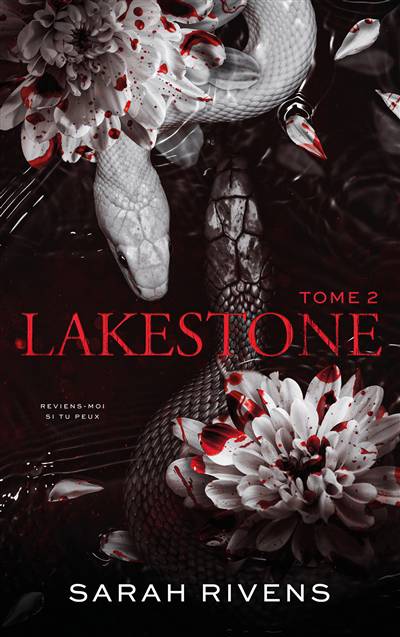
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
La place de Jacques Chessex au sein de la littérature suisse
romande est considérable, on ne l'affirmera jamais assez.
Force est de constater que son rayonnement à Paris n'en a pas fait
un auteur français ; il n'a pas connu ni subi le sort que l'Histoire a
réservé aux «grands ancêtres», Jean-Jacques Rousseau, Madame
de Staël, Benjamin Constant, Henri-Frédéric Amiel dont l'ancrage
helvétique a été totalement ou partiellement gommé. Cela étant,
son impact est supérieur à celui de Charles-Ferdinand Ramuz,
lequel n'avait pas pour objectif l'émergence d'une littérature
«nationale». Chessex briguait-il le statut de «seul, unique et
véritable père-fondateur» de la littérature suisse d'expression
française ? Il est à la fois un continuateur (il revendique son
appartenance à une chaîne d'écrivains) et un pionnier qui use
du modèle naturaliste mais le déborde, exhibant la force qui,
consubstantielle à tout ce qui est, précipite les êtres et les choses
vers leur fin. Il a organisé son existence en pansant ses blessures
dans l'ambivalence d'un «Je» qui dévoilait ses plaies autant qu'il
les dissimulait par le truchement d'une écriture conçue comme
une «confession» performative et conduite sous les regards des
lecteurs auxquels il reprochait pourtant leur accointance avec
le fini et de Dieu qu'il interpellait. Il était un croyant qui ne
méprisait pas le charnel, ses contemporains ne l'admettaient pas
toujours, lui s'en amusait volontiers.
Le présent essai, avec ses notes de traverses, s'efforce de restituer
le cheminement de son auteur dans l'oeuvre de cet important
écrivain.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 164
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782867819858
- Date de parution :
- 13-05-15
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 160 mm x 240 mm
- Poids :
- 316 g
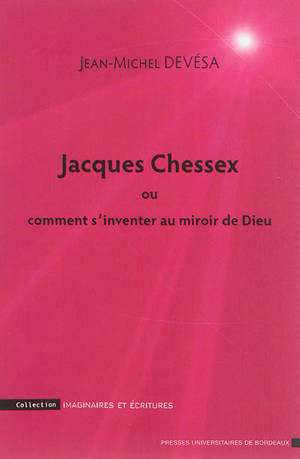
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.