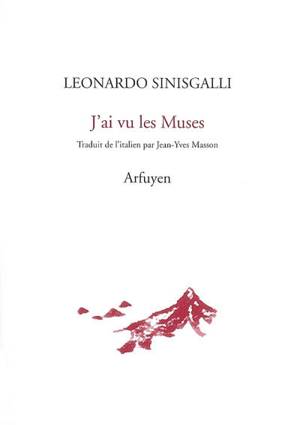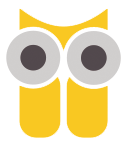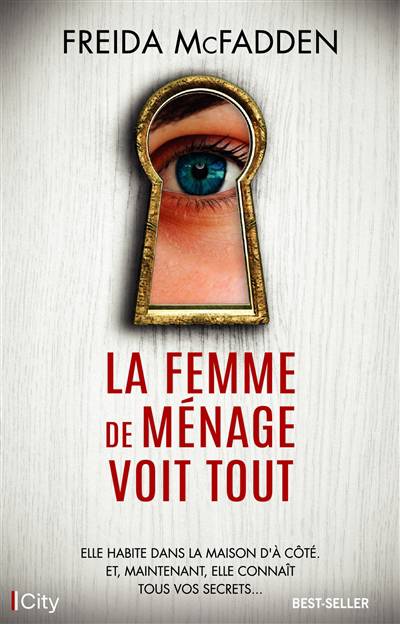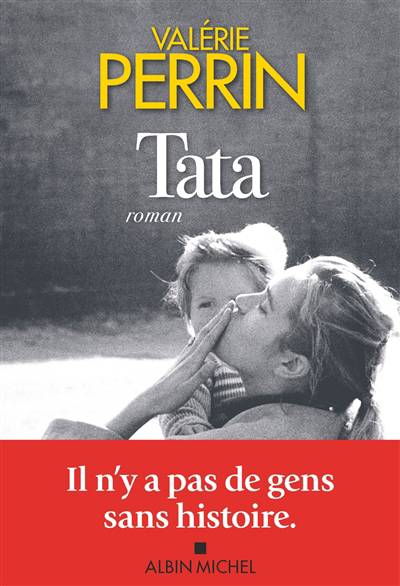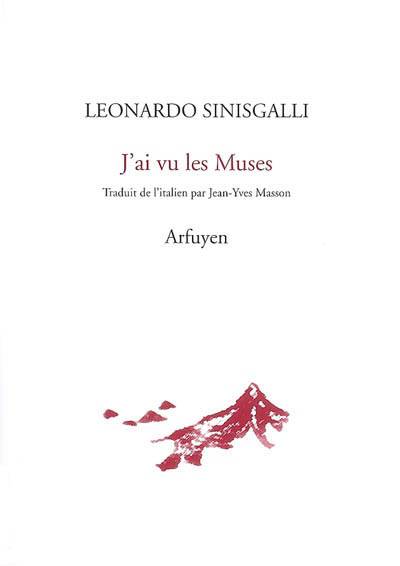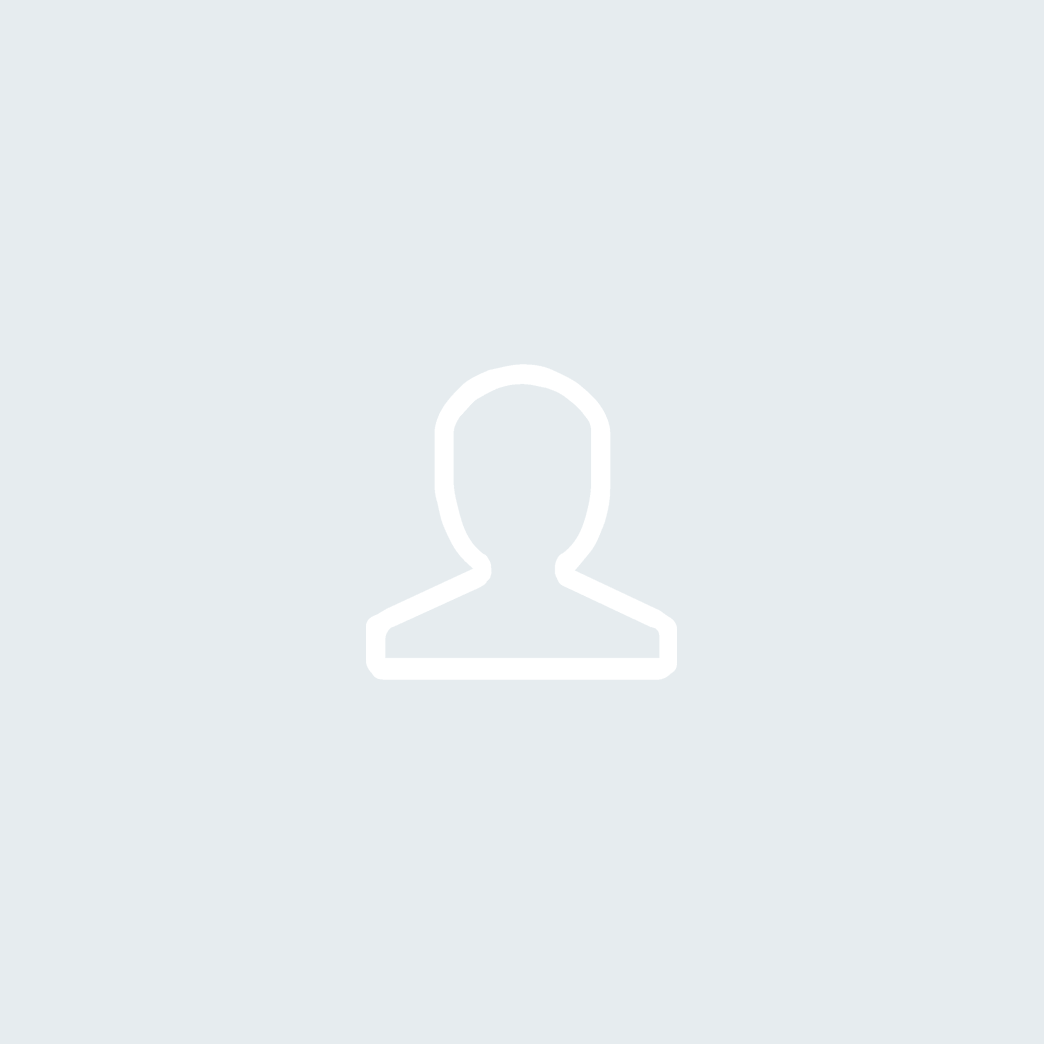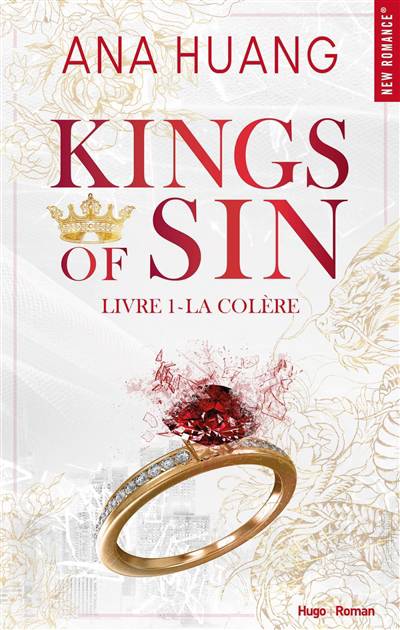
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
Publié en 1943 chez Mondadori, J'ai vu les Muses a imposé
Leonardo Sinisgalli (1908-1981) comme l'un des grands poètes
italiens de l'après-guerre.
L'été 1935, Sinisgalli retourne dans sa terre natale, cette Lucanie
- appelée aujourd'hui Basilicate - qui fut la patrie d'Horace.
L'automne venu, «quasi décidé à ne plus retourner en ville», il compose
les 18 poésies qui formeront le coeur de son recueil. Il y trouve soudain
son ton véritable, détaché des influences d'Ungaretti et de Quasimodo,
perceptibles dans ses premiers poèmes. Une personnalité se dessine,
en marge de l'«hermétisme» naissant auquel il lui arrivera -
notamment à Montale - de reprocher une excessive obscurité. La
réflexion sur les convergences entre poésie et sciences, la méditation
des conséquences pour l'homme des progrès de la technique, une vive
attention aux arts plastiques - lui-même dessine et peint -
constitueront les axes majeurs d'une pensée inlassablement tournée
vers le présent, mais revenant toujours à ses grandes références :
Léonard de Vinci, Descartes, Pascal.
Rétif à toute pose esthétique, Sinisgalli met en oeuvre une poétique
de la confidence, solidaire d'une éthique de la confiance et du partage.
Privilégiant les rythmes brefs et impairs, les textes de J'ai vu les Muses
affirment les traits majeurs qui caractériseront cette poésie : le refus
de l'éloquence, le goût du détail incongru, l'éloge des choses de la
vie quotidienne. Rarement poésie aura su faire voir avec autant de
justesse et de tendre ironie un monde saisi dans son essentielle
fragilité.
«J'ai vu les Muses» : cette affirmation, qui peut sembler
orgueilleuse, il faut l'entendre comme portée par un souffle ténu et
aussitôt mise à distance par un sourire gentiment moqueur, car les
Muses ne sont ici que de vieilles créatures au statut indéfini qui
«jacassent» dans un arbre... Dans sa subtilité, son humour et sa
discrétion revendiquée, l'oeuvre de Sinisgalli nous apparaît aujourd'hui
comme l'une des plus puissamment personnelles de ce temps.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 209
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782845900974
- Date de parution :
- 01-02-07
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 170 mm x 230 mm
- Poids :
- 345 g