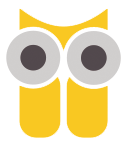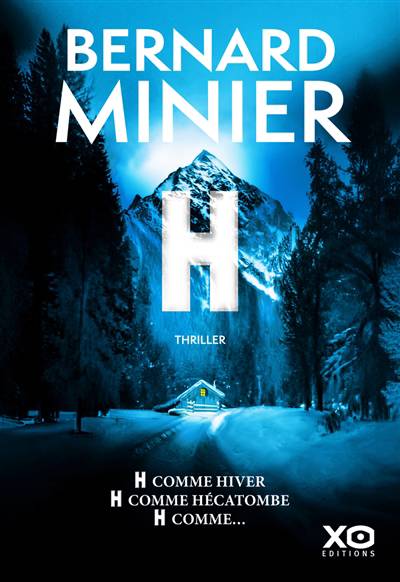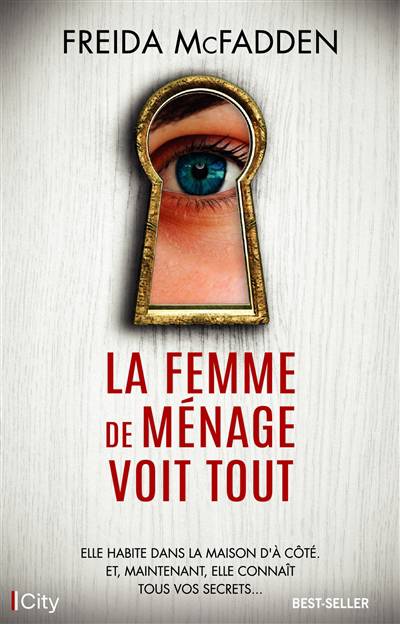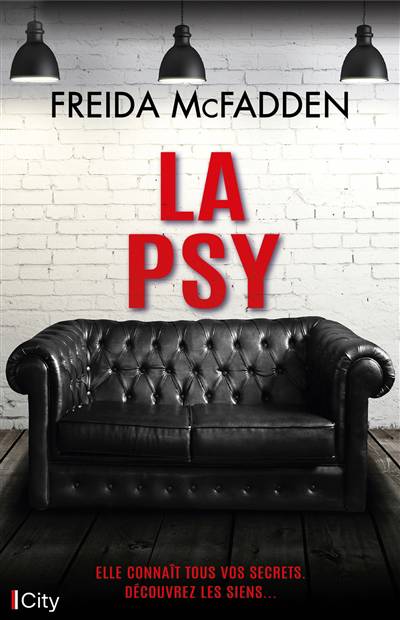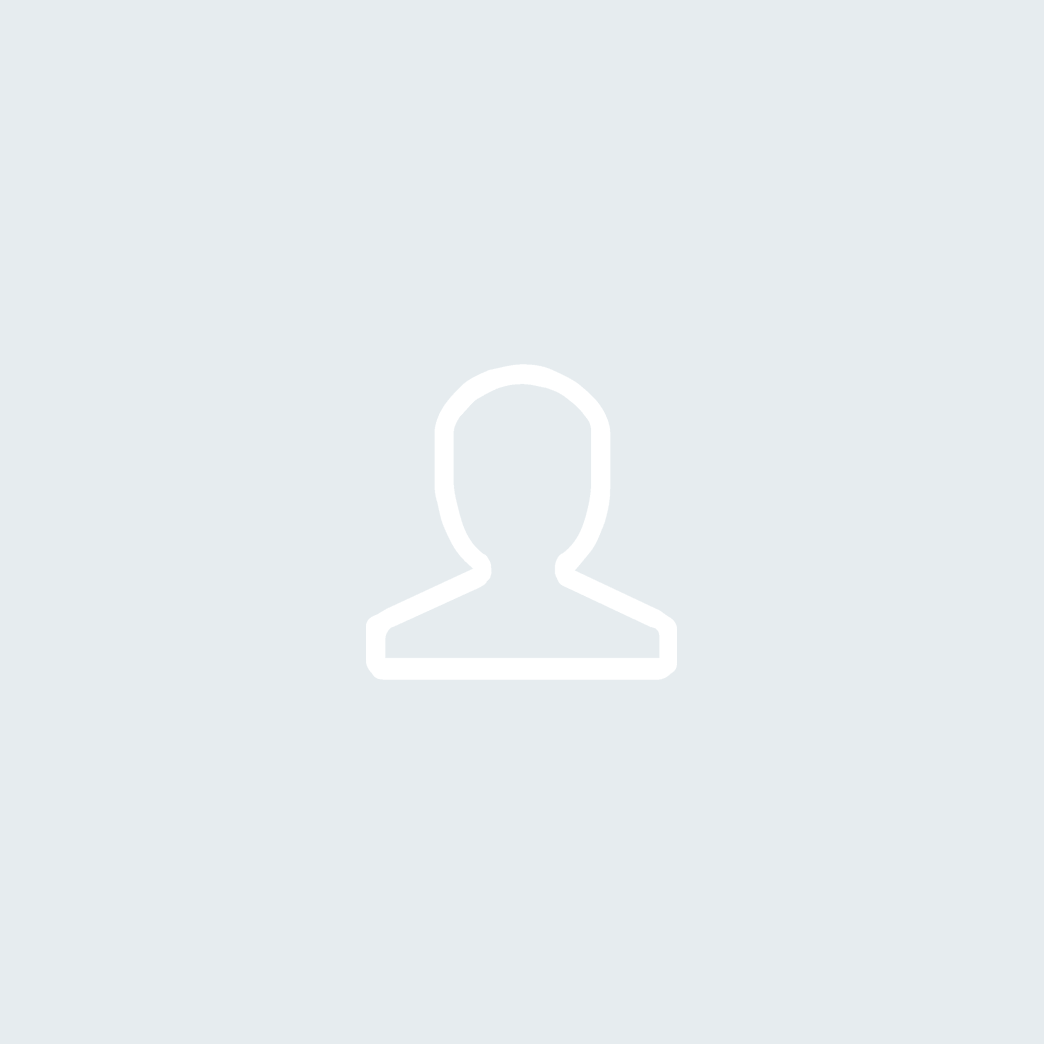- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
L'homme sait qu'il doit mourir et l'on s'accorde habituellement à
voir dans ce savoir de sa propre mortalité un des caractères
essentiels de l'humanité, à côté du langage, de la pensée et du rire.
Or les religions, les métaphysiques, la culture humaine tout entière
se sont donné pour programme de vaincre la mort. Et la philosophie
occidentale, de Platon à Hegel, a à son tour affirmé que c'est
dans l'exercice même de la pensée que la mort et la finitude se
voient surmontées.
On se propose ici, dans un premier temps, d'analyser ces tentatives
métaphysiques, religieuses et philosophiques de déploiement d'un
au-delà de la mort, pour entreprendre ensuite de montrer qu'il est
pourtant possible d'entretenir un rapport à la mort qui ne soit ni
une manière de «s'y apprivoiser», comme le dit Montaigne, ni une
manière de l'esquiver.
C'est en prenant appui sur l'analyse de l'être pour la mort que propose
Heidegger qu'on tente alors de faire apparaître qu'il existe un
autre discours sur la mort qui exige comme sa condition de possibilité
une libre assomption de la finitude de l'existence humaine.
Une telle conception de la finitude, qui n'est plus adossée à
l'infinitude d'un être hors la mort et hors temps du divin, reconduit
l'être humain à sa facticité originaire, c'est-à-dire à son caractère
proprement terrestre, temporel et corporel. Une telle pensée de
la mortalité comme finitude constitutive de l'ouverture au monde
est en même temps une pensée de la naissance comme capacité
finie d'avoir un monde, le mourir étant ici la condition du naître et
la mort celle de la vie.
Ce qui nous est alors révélé, c'est que c'est dans la joie et le rire
que, paradoxalement, nous entretenons le rapport le plus authentique
à notre propre mortalité.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 202
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782130556886
- Date de parution :
- 17-09-07
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 150 mm x 220 mm
- Poids :
- 280 g

Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.