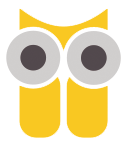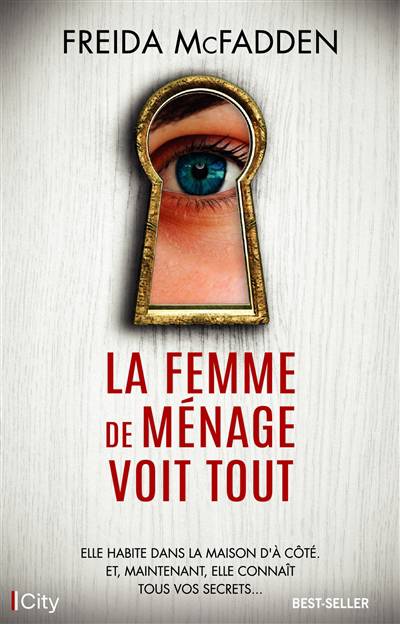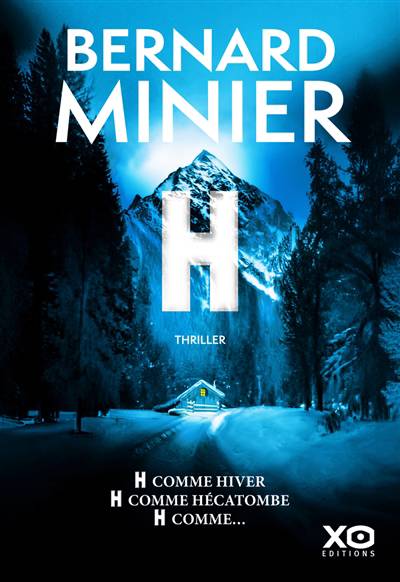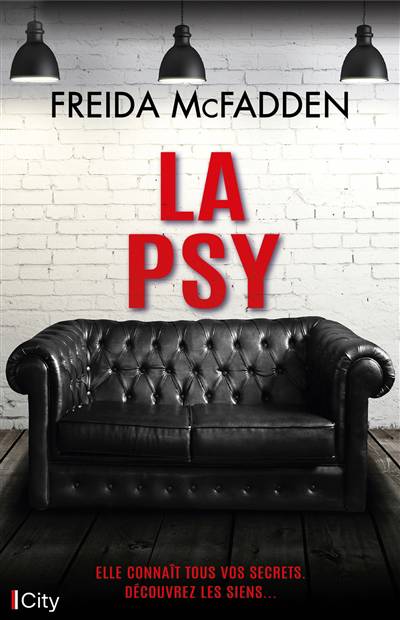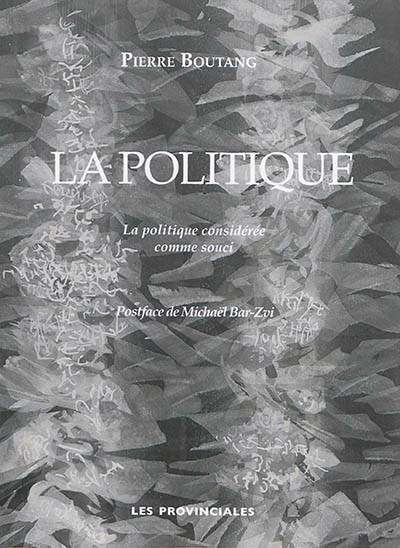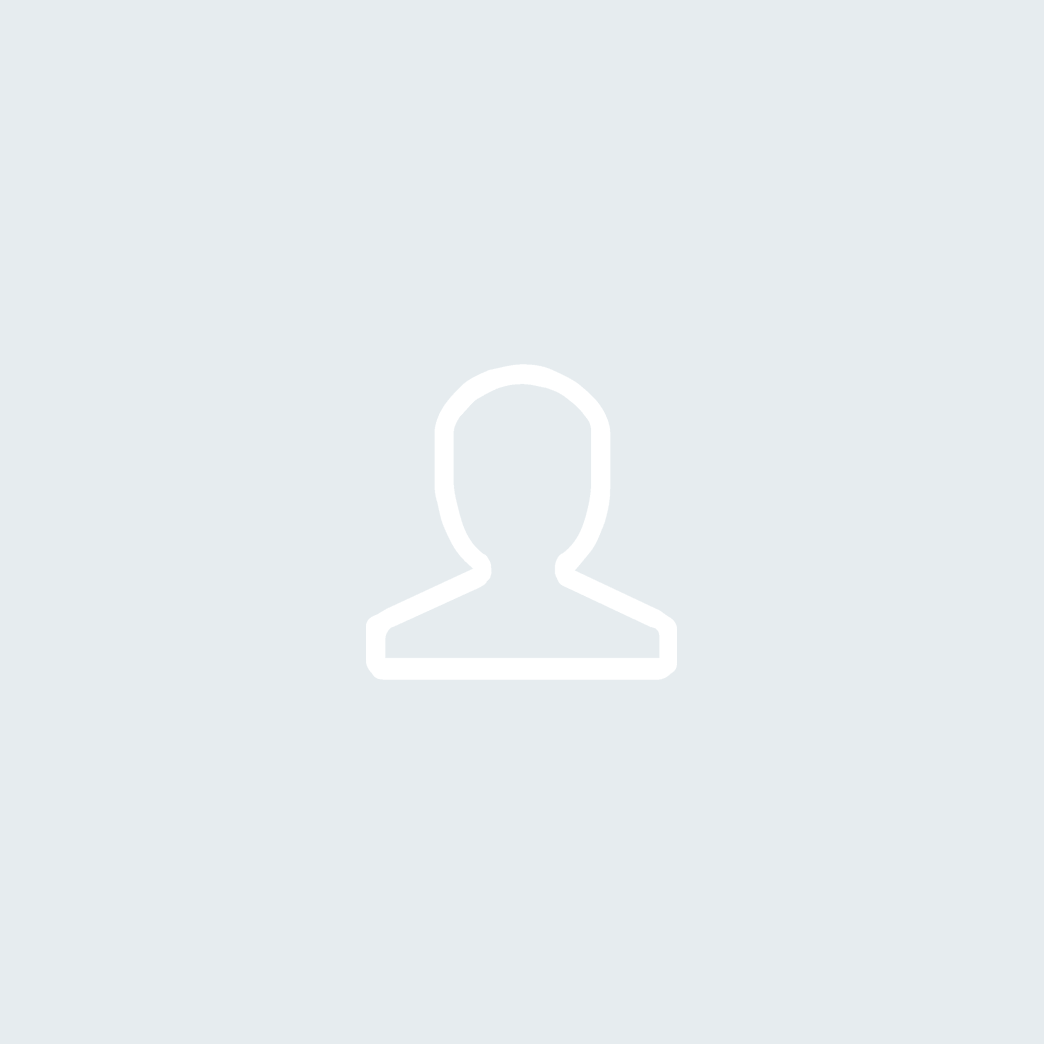- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
L'existence d'un homme dont je dépendais,
qui me donnait le nom qu'il avait reçu, qui
créait dans la relation à moi une situation
irréductible, était l'inépuisable matière de ma
première réflexion. Cela était ainsi, il était mon
père, c'était un «fait». Mais ce fait était
originel, il était plus spirituel que l'esprit, il
absorbait, pour ainsi dire, l'esprit, et remplissait
la solitude. Il créait une «puissance» légitime
que rien ne pouvait me faire contester.
Sans doute, les tristes abstractions dont la
société libérale et bourgeoise, autour de 1928,
continuait à se mystifier elle-même, pouvaient
être facilement rejetées. J'étais boursier dans
un lycée de province, et je savais par contact,
quelle dérision c'était que l'égalité humaine
proclamée par cette société. Je pense que les
garçons de mon âge et de ma condition, si
la crise française avait été aussi aiguë que la
crise allemande, et s'ils avaient rencontré un
message analogue à celui de Hitler, auraient
été assez facilement «nationaux-socialistes»
et auraient renié toutes les lois non écrites,
dans le saccage des valeurs abstraites
superficielles qui coïncidaient avec le
contenu idéal de la «démocratie»...
Pour moi, l'étonnement et l'ivresse devant
les formes particulières, les idées naissant au
contact même des choses étaient un risque
certain. Elles créaient une indifférence
morale complète, et m'absorbaient dans la
particularité. Les préceptes, par eux-mêmes,
auraient été sans force contre un mouvement
toujours plus ivre de connaissance.
C'est l'autorité de mon père (le fait
qu'il reconnaissait les lois non écrites),
qui me maintint au moins théoriquement
dans leur domaine.
Pierre Boutang
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 158
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782912833341
- Date de parution :
- 06-06-14
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 150 mm x 200 mm
- Poids :
- 190 g
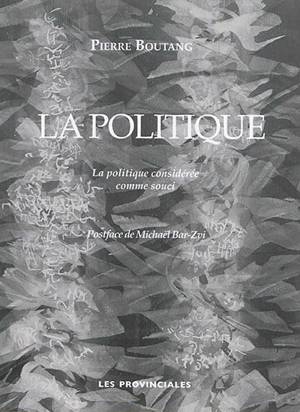
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.