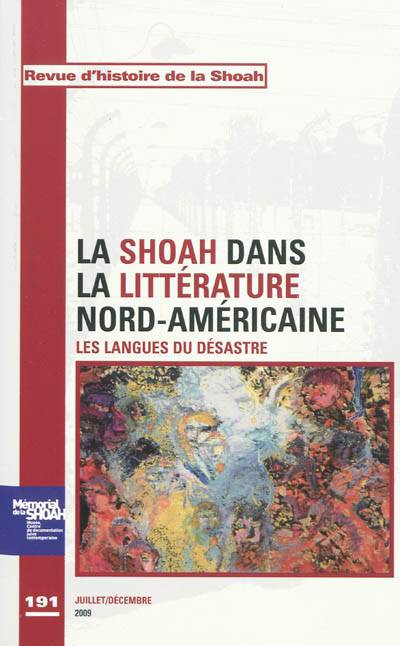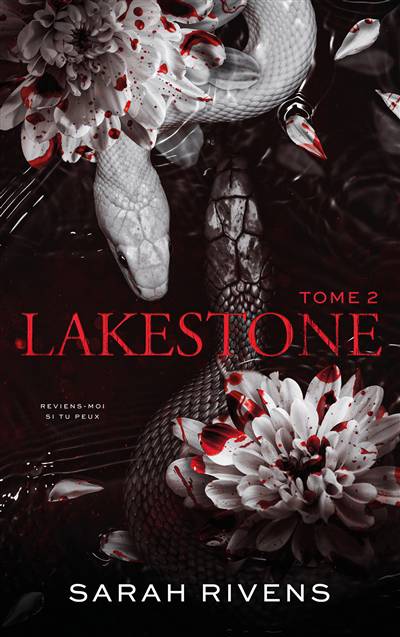
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
La Shoah dans la littérature nord-américaine
les langues du désastre
Memorial De La ShoahDescription
La multiplication des lieux mémoriels érigés sur le territoire
des États-Unis dans les récentes décennies a fait du génocide
des Juifs une «douleur américaine». L'oeuvre de mémoire y
semble désormais assumée par les espaces commémoratifs et
les filières universitaires spécialisées. Le silence des arts dans
l'après-guerre a progressivement cédé la place à un enracinement
d'une ampleur telle que l'on peut parler aujourd'hui d'une
centralité de la Shoah dans l'identité judéo-américaine autant
que dans la conscience collective au niveau national.
Quel usage les écrivains du continent nord-américain ont-ils fait de cette
mémoire de «seconde main» ? L'institutionnalisation de la mémoire de
l'événement semble avoir laissé le champ libre aux auteurs de fiction et aux
poètes pour «recomposer» l'événement, pour devenir «metteurs en mots».
Pour ceux qui sont issus des vagues migratoires anciennes, l'expérience
génocidaire reste extérieure ; les enfants de rescapés sont, eux, porteurs
d'une mémoire familiale et la catastrophe historique est devenue catastrophe
intime. En parallèle aux formes traditionnelles d'expression narrative (textes
de fiction longs ou brefs, poésie), des supports inédits, tel le roman graphique,
ont été expérimentés. La «mise en récit» est marquée par la tension entre
approches possibles de l'événement : est-il objet d'histoire ou désastre métaphysique,
doit-il être appréhendé dans sa littéralité ou peut-il devenir métaphore
? Toutefois, quelle que soit la forme d'écriture privilégiée, l'exigence
intellectuelle et éthique est identique : le processus créatif doit inscrire le
Désastre au coeur esthétique et moral de l'oeuvre.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 402
- Langue:
- Anglais, Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782916966007
- Date de parution :
- 14-10-09
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 150 mm x 240 mm
- Poids :
- 627 g
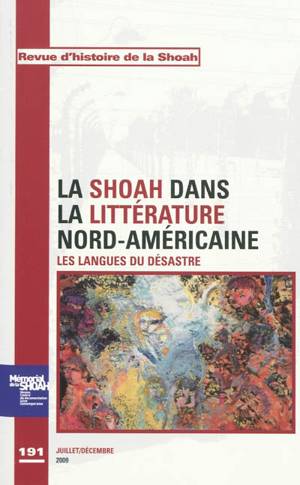
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.