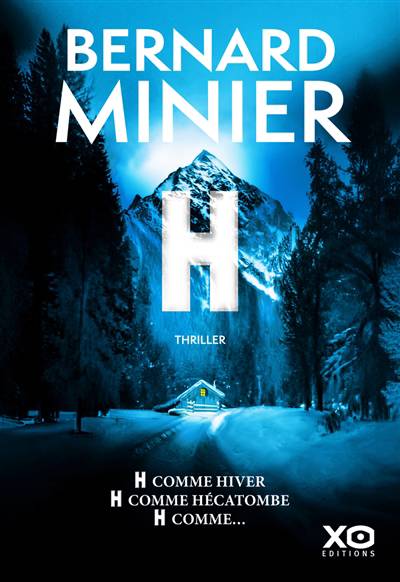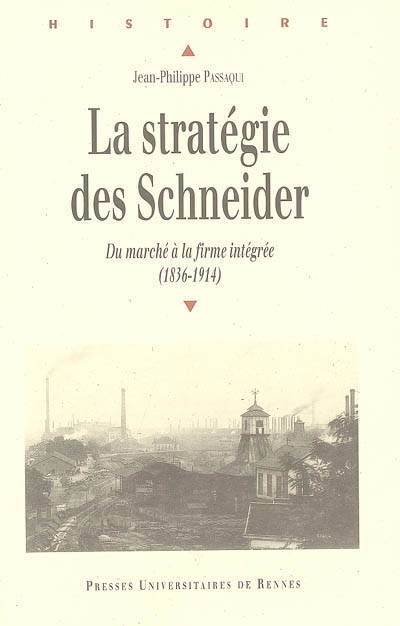- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
La stratégie des Schneider
du marché à la firme intégrée (1836-1914)
Jean-Philippe PassaquiDescription
«Pierre le matin, fonte le soir.» Ces quelques mots rédigés par le journaliste
Simonin, au terme d'une visite de l'usine du Creusot et des mines qui l'alimentent,
font ressortir la singularité des établissements Schneider et Cie. Vers
1860-1870, cette entreprise est capable d'extraire puis d'expédier les matières premières
et les combustibles nécessaires au bon fonctionnement de la plus grande usine
sidérurgique de France.
Pour parvenir à ce résultat, les Schneider, gérants de l'entreprise issus d'une des
plus prestigieuses dynasties de maîtres de forges, sont amenés à se lancer dans une
stratégie d'expansion ambitieuse, basée sur un fort degré d'intégration. Pareille orientation
est esquissée à partir des années 1840, avant d'être confortée au cours des
années 1860. À cette époque, l'environnement minéral du Creusot n'est plus en mesure
de fournir les charbons et les minerais nécessaires aux productions sidérurgiques qui
font la prospérité et la réputation de l'usine. Eugène Schneider doit se tourner vers
des fournisseurs extérieurs qui sont rarement soucieux de respecter les contrats
signés. Le brillant sidérurgiste doit devenir exploitant minier.
Entre les deux dates, il a réuni à son entreprise un ensemble d'exploitations
minières regroupées sous le terme de Domaine minier. Celui-ci devient un élément
déterminant de la politique industrielle des établissements Schneider et Cie. Mais sa
constitution hypothèque, en définitive, les possibilités de redéployer une partie des
activités de l'usine du Creusot vers les régions qui sont, à l'instar de la Lorraine, plus
aptes à la fabrication de produits sidérurgiques courants. À la veille de la Première
Guerre mondiale, l'intégration cesse d'être une force et une spécificité de l'entreprise
pour devenir un facteur d'immobilisme et de perte de compétitivité.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 403
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782753501812
- Date de parution :
- 09-03-06
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 160 mm x 240 mm
- Poids :
- 501 g
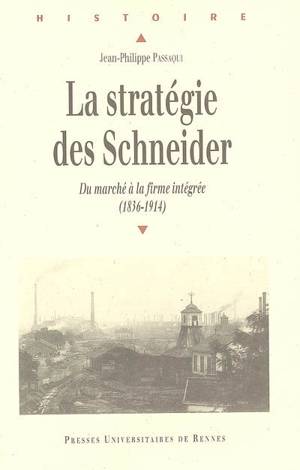
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.