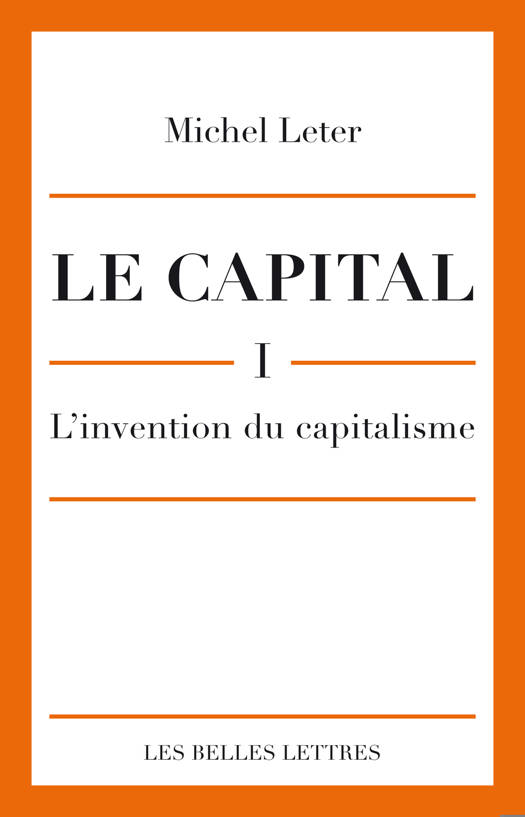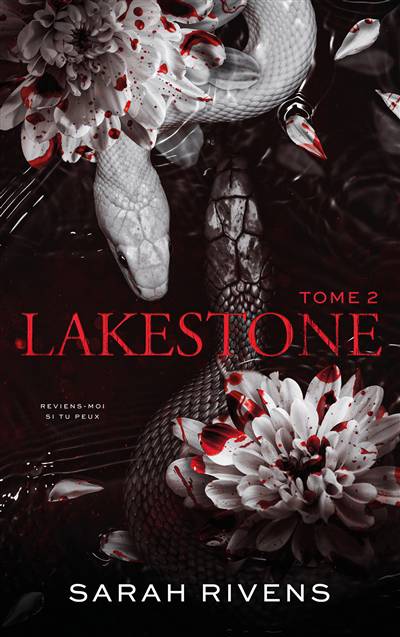
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
17,99 €
+ 17 points
Description
Résumée par la formule d'Yves Guyot « le capital, c’est l’homme », l’anthropologie du capital n’a pas été élaborée par Marx mais par l’école française. La sociologie travailliste ne parvient pas à faire l’économie de l’anthropogenèse par le capital et Marx lui-même confessera que « des historiens bourgeois avaient exposé » bien avant lui « l’évolution historique de cette lutte des classes et des économistes bourgeois en avaient décrit l’anatomie économique ». Leter identifie les auteurs évoqués par Marx et brosse un panorama de leur approche du capital : Quesnay, concepteur de la notion de classe ; Condorcet, pionnier capitalien de la république ; Destutt de Tracy, père de l’idéologie ; Charles Dunoyer, auteur du texte fondateur de la lutte des classes ; Adolphe Blanqui, premier historien de la pensée économique ; Augustin Thierry, Ambroise Clément et Bastiat, historiens de la spoliation légale ; autant d’esprits qui observent que le capital est universel et que, tandis que les excès de l’individualisme sont limités par la loi et que rien ne régule les abus du collectivisme, le véritable antagonisme de classe n’oppose pas ceux qui accapareraient le capital à ceux qui en seraient dépourvus mais ceux qui le créent à ceux qui vivent de sa destruction.
Après avoir réhabilité l’idéologie telle qu’elle fut conçue par Destutt de Tracy avant d’être détournée par Marx, Michel Leter actualise les analyses de Jean-Baptiste Say, Charles Coquelin et Yves Guyot, en proposant la définition suivante : « Le capital est dans l’ordre de la création ce qui ne vient pas du Créateur mais de la créature. Propriété d’un individu ou d’une communauté de savoir, il est constitué par l’ensemble des valeurs antérieurement soustraites tant à la consommation improductive qu’à la production stérile et que le passé a léguées au présent. »
Cependant le grand paradoxe du capitalisme est qu’il n’a pas été forgé par ceux qui plaident la cause du capital mais par ses ennemis. Michel Leter entreprend alors de traquer le capitalisme au cœur de la poétique collectiviste dont l’étude permet de comprendre que le capitalisme n’est pas un système économique mais un mythe qui a pour fonction d’imputer au libéralisme les maux causés par le socialisme.
Après avoir réhabilité l’idéologie telle qu’elle fut conçue par Destutt de Tracy avant d’être détournée par Marx, Michel Leter actualise les analyses de Jean-Baptiste Say, Charles Coquelin et Yves Guyot, en proposant la définition suivante : « Le capital est dans l’ordre de la création ce qui ne vient pas du Créateur mais de la créature. Propriété d’un individu ou d’une communauté de savoir, il est constitué par l’ensemble des valeurs antérieurement soustraites tant à la consommation improductive qu’à la production stérile et que le passé a léguées au présent. »
Cependant le grand paradoxe du capitalisme est qu’il n’a pas été forgé par ceux qui plaident la cause du capital mais par ses ennemis. Michel Leter entreprend alors de traquer le capitalisme au cœur de la poétique collectiviste dont l’étude permet de comprendre que le capitalisme n’est pas un système économique mais un mythe qui a pour fonction d’imputer au libéralisme les maux causés par le socialisme.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 416
- Langue:
- Français
- Collection :
- Tome:
- n° 1
Caractéristiques
- EAN:
- 9782251900629
- Date de parution :
- 22-02-15
- Format:
- Ebook
- Protection digitale:
- Digital watermarking
- Format numérique:
- ePub
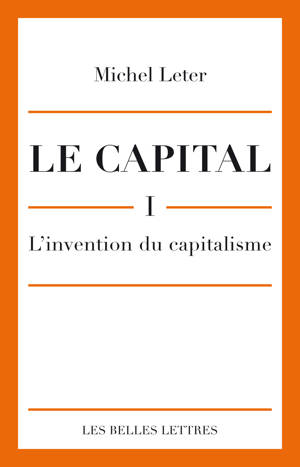
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.