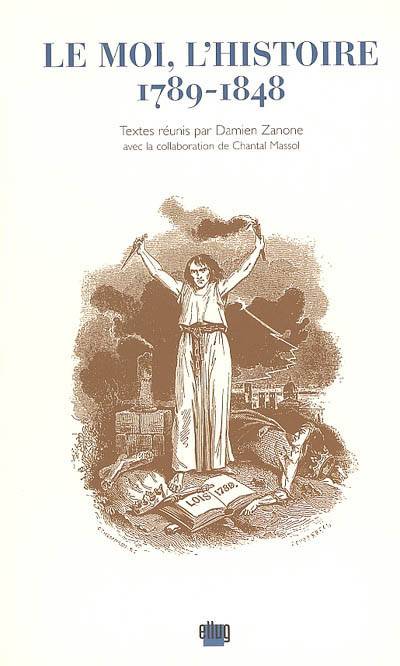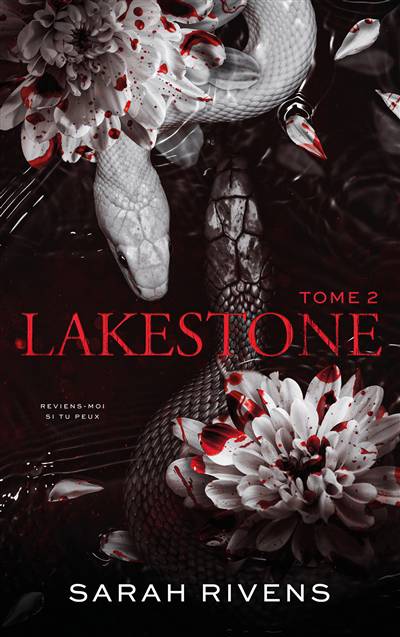
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
Culte du moi, culte de l'histoire ; égotisme, historicisme...
Les manuels d'histoire littéraire retiennent souvent ces
formules synthétiques pour qualifier le nouveau cours
de la production littéraire et de la vie de l'esprit dans la
première moitié du XIXe siècle. Juxtaposées, elles exprimeraient
la double postulation du romantisme français -
et son double prestige.
Le présent volume voudrait réinterroger l'attrait qu'exercent,
sur les auteurs du premier XIXe siècle, l'écriture du moi
et l'écriture de l'histoire, afin de repenser la rencontre des
deux. Celle-ci se fait-elle dans une écriture de la mémoire ?
Quels liens penser entre écriture de soi et période historique
troublée ? Comment être soi dans l'histoire ?
Ces enjeux ont certainement une portée générale qui
ne concerne pas les seuls auteurs approchés ici (Staël,
Chateaubriand, Stendhal, Sand, Desbordes-Valmore,
Nerval, Tocqueville et Michelet). Mais la période post-révolutionnaire,
1789-1848, tout occupée qu'elle est de
trouver à dire la place de chacun dans le monde, pose ces
questions avec une particulière acuité. Si écriture de soi et
écriture de l'histoire apparaissent comme les modalités
fondamentales de l'expression romantique en France, la
mise en relation des deux peut ajouter des éléments à ce
qu'on tiendra pour une archéologie de ce romantisme.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 193
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782843100635
- Date de parution :
- 04-05-05
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 140 mm x 220 mm
- Poids :
- 248 g
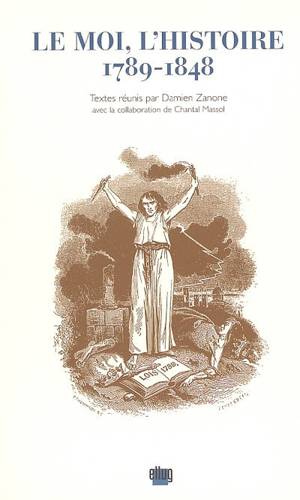
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.