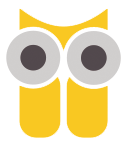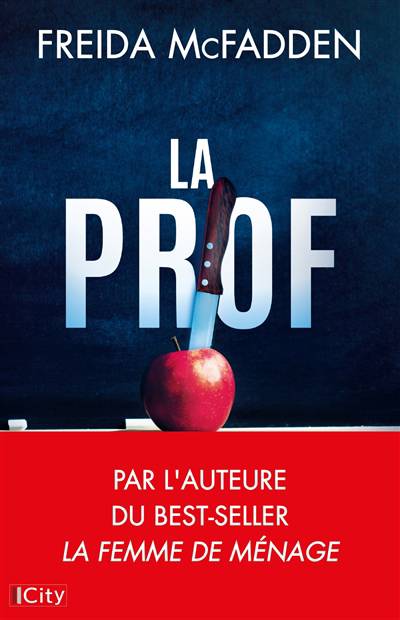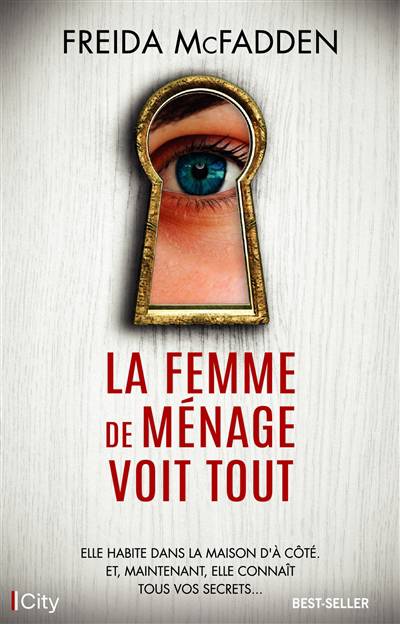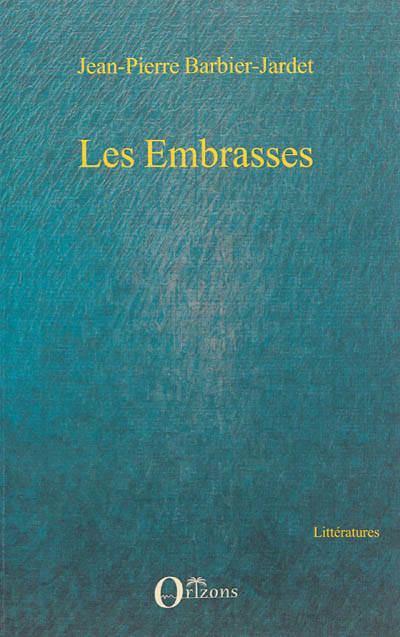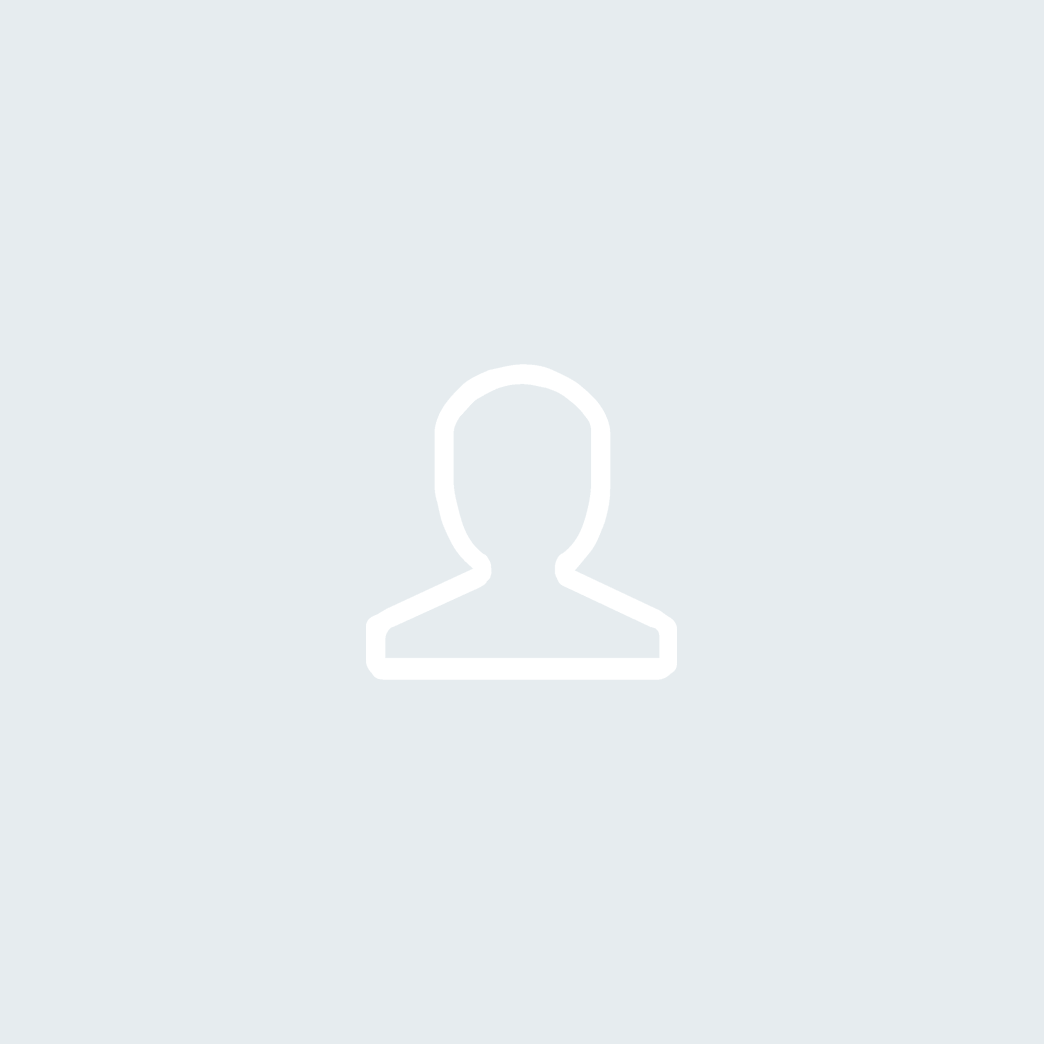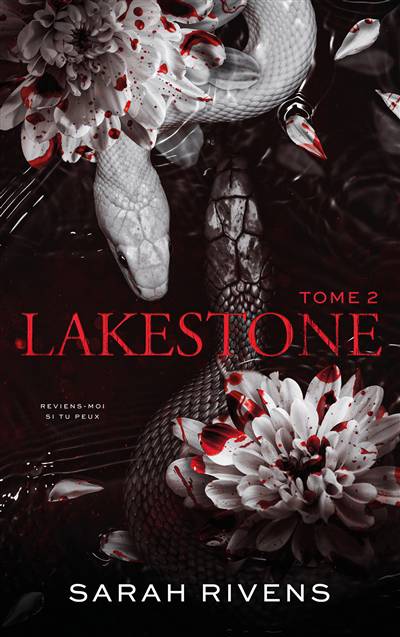
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
En 1920 paraissait La Promenade, Der Spaziergang, de Robert Walser, cet
écrivain suisse qui vécut ses vingt-trois dernières années à l'asile de Herisau.
Pour cet auteur la promenade n'est rien d'autre qu'un fil conducteur pour des
rencontres. Les rencontres elles-mêmes sont moins importantes par l'objet
ou la personne qui en sont l'occasion que par leur charge spirituelle, les
signes qu'ils distribuent et qu'il appartient au seul promeneur d'interpréter,
voire d'inventer.
Baudelaire écrit en conclusion du portrait de l'aquarelliste Constantin
Guy : «La fantasmagorie a été extraite de la nature. Tous les matériaux
dont la mémoire s'est encombrée se classent, se rangent, s'harmonisent
et subissent cette idéalisation forcée qui est le résultat d'une perception
enfantine, c'est à dire d'une perception aiguë, magique à force d'ingénuité».
Ainsi je me suis inspiré de l'architecture de l'oeuvre de Robert Walser. La
promenade que je mets en scène suit le trajet de cet auteur et s'ouvre à cette
pensée magique issue de l'enfance qu'évoque Baudelaire.
Cette déambulation est une descente aux enfers, une confrontation aux
fantômes, une évocation de la quête amoureuse, du désir inextinguible et
de la perte irrémédiable. «Ai-je cueilli des fleurs pour les déposer sur
mon malheur ?» s'écrie l'auteur à la fin du livre, lui qui mourut en 1956,
le jour de Noël ; quittant la clinique pour une promenade dans la neige, il
marchera jusqu'à l'épuisement et la mort.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 215
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782336298306
- Date de parution :
- 15-12-13
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 150 mm x 240 mm
- Poids :
- 340 g
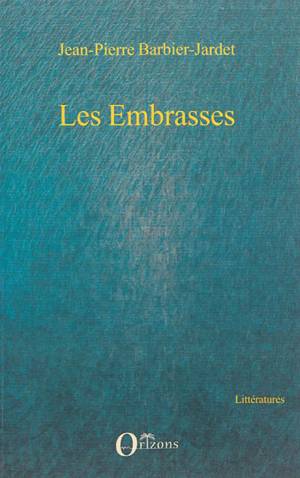
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.