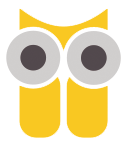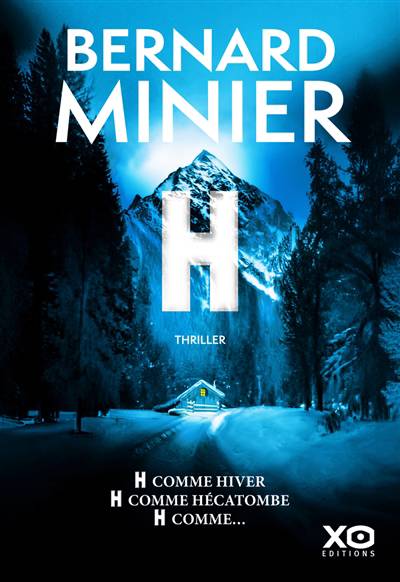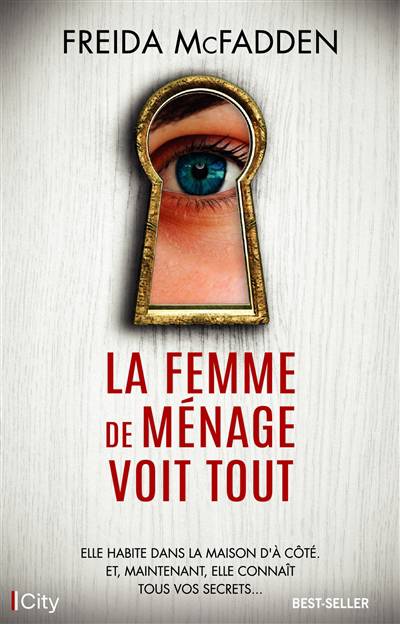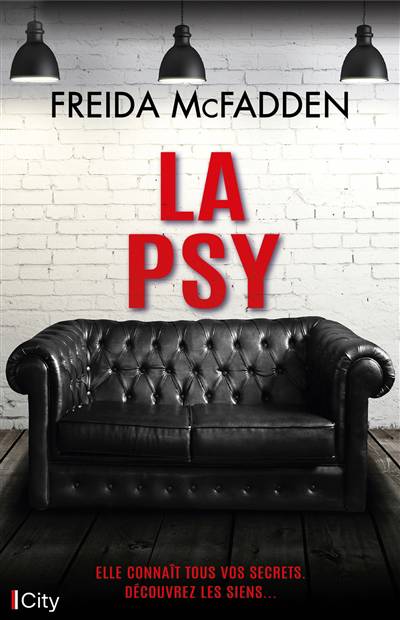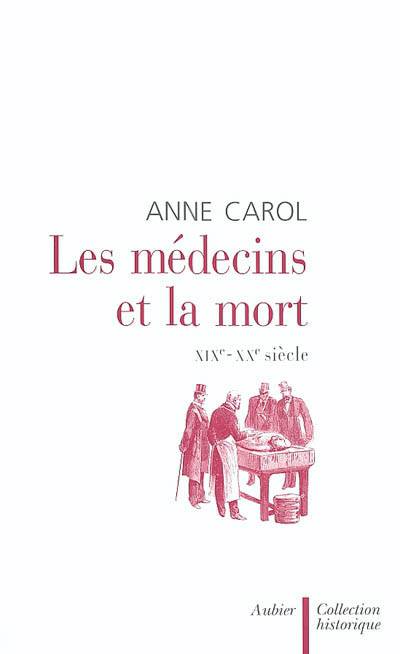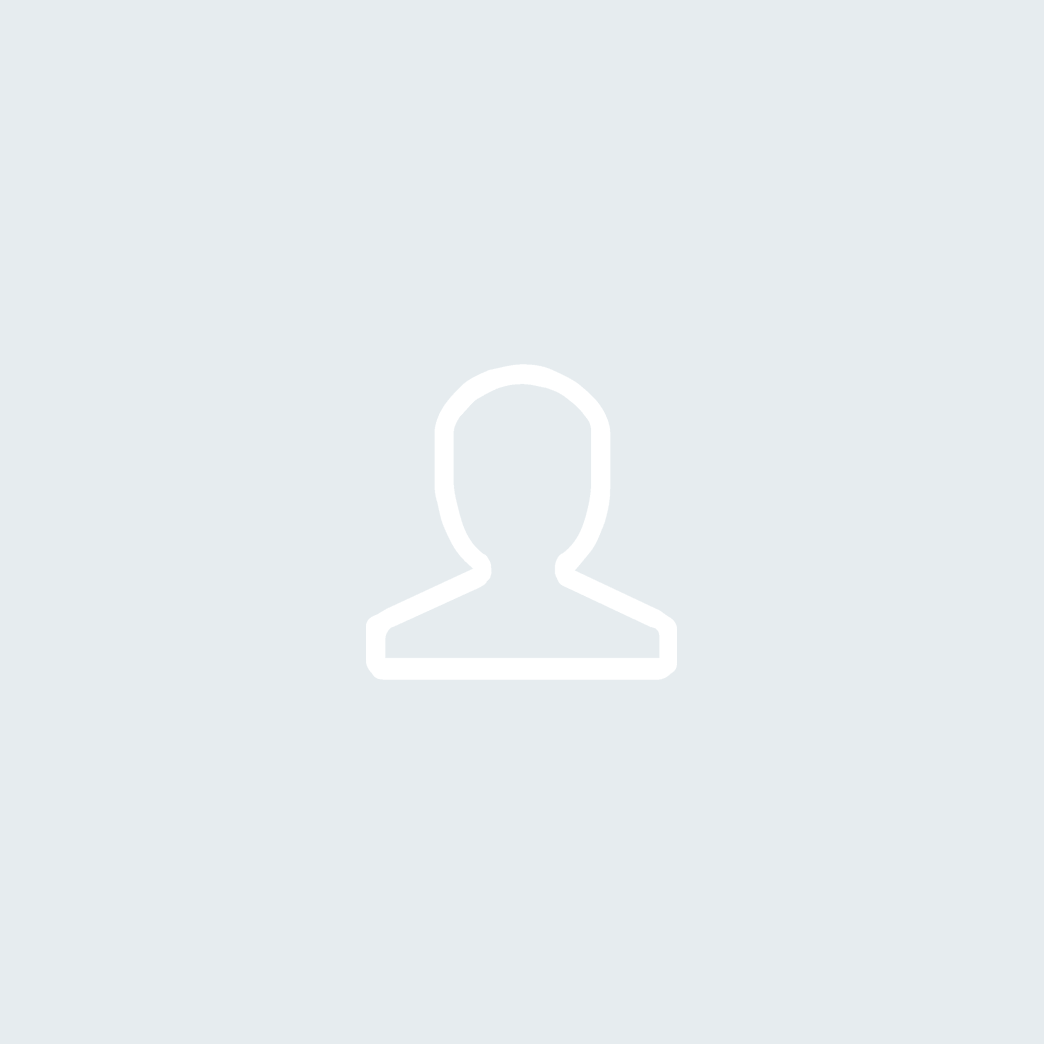- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
En deux cents ans, la mort s'est médicalisée et, au
chevet du mourant, le médecin a remplacé le
prêtre. Mais les questions que soulève le rapport des
médecins à la mort n'ont guère changé. Que faire
face à un malade que l'on sait condamné ? Comment
l'accompagner jusqu'à la fin ? Faut-il prolonger ou
abréger son agonie, faut-il l'adoucir ?
Savoir si le patient est bel et bien mort est une
préoccupation qui n'a cessé d'être centrale depuis
deux siècles. La recherche d'une preuve
incontestable du décès n'est pas seulement
affaire de scrupule scientifique, elle est
aussi induite par la peur : le grand effroi du
XIXe siècle, c'est d'être enterré vivant, et, pour
s'assurer qu'aucune étincelle de vie ne
demeure, le cadavre fait parfois l'objet de
«tortures» effroyables à nos yeux. Depuis,
les peurs se sont déplacées ; ce que nous redoutons
pour nous et pour nos proches, ce sont ces morts qui
n'en sont pas : les comas, les états végétatifs.
Quant à l'euthanasie ou à l'«acharnement thérapeutique»,
ces débats agitent la communauté des
médecins dès le XIXe siècle, avec des mots différents,
bien sûr. Le problème de la douleur, en revanche, ne
sera pris en compte que bien plus tard : il faut
attendre les années 1960 pour que les médecins
voient en elle autre chose qu'un mal nécessaire,
voire un symptôme utile pour la science.
L'ultime question, en somme, pour les médecins d'hier
et d'aujourd'hui, serait peut-être : la mort est-elle un
ennemi à combattre ou un territoire à conquérir ?
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 335
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782700723311
- Date de parution :
- 16-04-04
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 140 mm x 220 mm
- Poids :
- 345 g

Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.