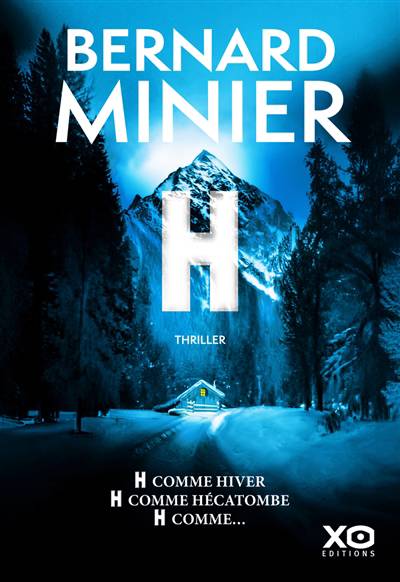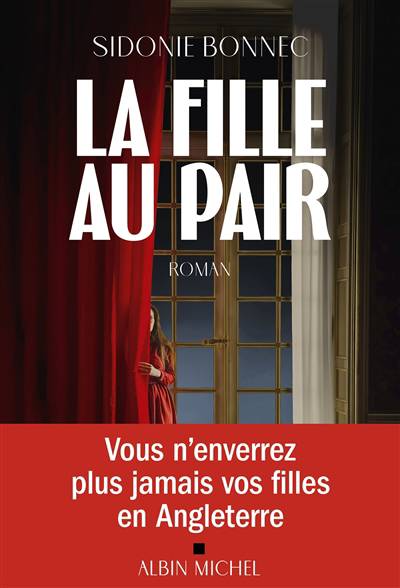- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
Les modalités de répartition des compétences entre la Communauté et
ses États membres, soigneusement ignorées des rédacteurs du Traité de
Rome, ne peuvent plus être occultées. Enjeux de la réforme de l'Union
européenne en 2004, la définition et la clarification de la répartition des
compétences sont des conditions de la poursuite de l'intégration
européenne.
Cette question allie simplicité et complexité. En effet, le principe
fondateur des compétences communautaires - à savoir le principe des
compétences d'attribution - se présente à bien des égards comme étant,
selon la formule parlante du juge Pescatore, «une absurdité congénitale
de nos traités».
Une tension point entre le pouvoir des États, maîtres de la répartition
conventionnelle des compétences, et le développement de ces
compétences par les institutions communautaires qui pourraient être
suspectées de s'octroyer «la compétence de la compétence».
Mais la guerre n'a pas eu lieu. Bien au contraire, l'analyse du droit
dérivé, de la jurisprudence et des actions nationales démontre que la
théorie des compétences communautaires se fonde sur une conciliation
des volontés étatiques et communautaires. L'extension des compétences
communautaires en marge des traités est voulue par les institutions
communes mais également suscitée par les États. La défense de leurs
intérêts, au travers de procédures spécifiques telle que la coopération
renforcée, est le contre-poids de l'expansionnisme communautaire. Plus
généralement, les caractéristiques des compétences nouvellement
dévolues à la Communauté européenne témoignent d'un équilibre entre
l'accroissement des compétences communautaires et la défense des
compétences nationales. L'intégration ne se fait plus par l'abolition de la
compétence nationale. Cette compréhension mutuelle de la juste mesure
des compétences communautaires conduit à une mosaïque de forme de
compétence dont une présentation claire sera certainement l'ultime étape
de la construction communautaire.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 704
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782747540674
- Date de parution :
- 03-03-03
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 160 mm x 240 mm
- Poids :
- 1125 g
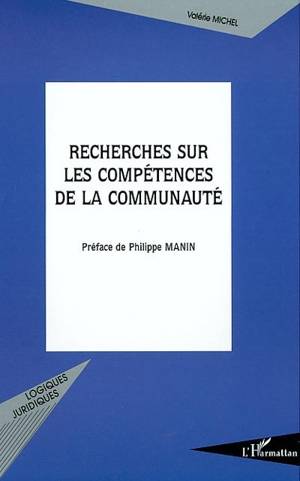
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.