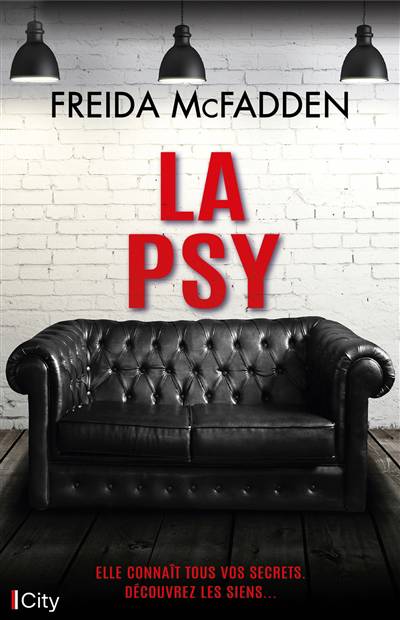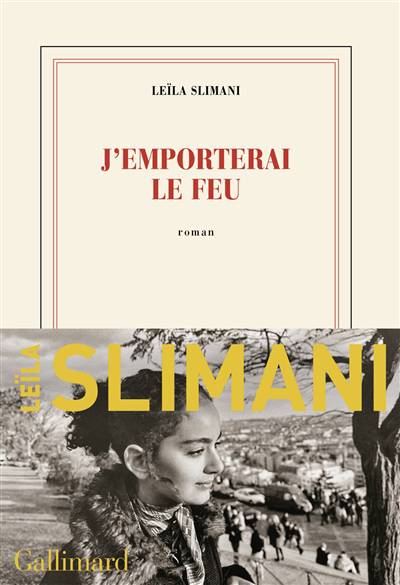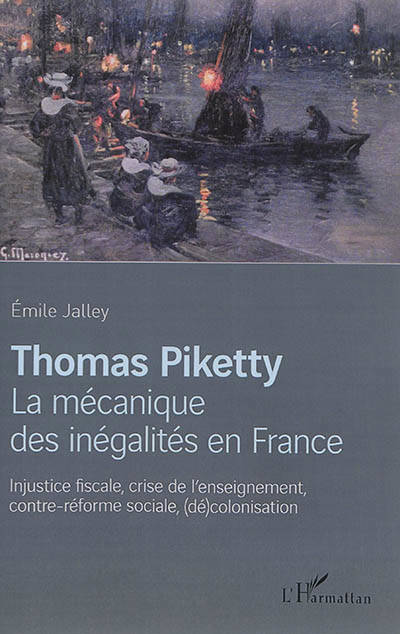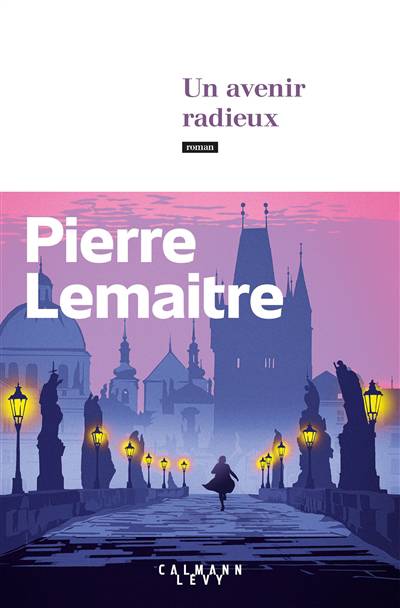
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Thomas Piketty, la mécanique des inégalités en France
injustice fiscale, crise de l'enseignement, contre-réforme sociale, (dé)colonisation
Emile JalleyDescription
Les deux symptômes majeurs de la maladie française sont l'injustice
fiscale et la crise de l'enseignement. Le premier serait remédiable à
court terme sous réserve d'une véritable volonté politique. Le second
résulte d'une pathologie institutionnelle endurée depuis les années
1950, et est devenu de plus en plus difficile à maîtriser.
L'inégalité fiscale tient à l'hypofiscalisation et l'hyperfiscalisation
relatives de deux grandes classes, celle «d'en haut» et celle «d'en
bas» - constat d'une évidence contraire à tous les préjugés reçus - qui
jouent dans le sens de l'ouverture croissante du spectre des inégalités
dans la répartition du revenu social et de son épargne.
L'inégalité scolaire tient à ce que le dispositif institutionnel de
l'Éducation nationale n'a pas d'autre fonction réelle, contrairement à
la rhétorique officielle, que d'ouvrir le chemin, vers «le haut» et vers
«le bas», à la distribution inégalitaire des revenus et des patrimoines.
L'inégalité socio-économique, au bénéfice de l'accroissement des
inégalités de revenus et de capital, tient largement à la régression
progressive de l'«État social» institué par le Conseil National de la
Résistance en 1943.
L'inégalité civique et politique représente l'autre face, presque aussi
malencontreuse, de cet héritage social, celle liée aux séquelles
lointaines de la (dé) colonisation.
Ce livre a été conçu en jumelage avec un autre intitulé : Thomas
Piketty «Marx du 21e siècle» ?. Mais chacun peut être lu de façon
indépendante.
Un profil et une bibliographie de l'auteur se trouvent à l'intérieur du
volume aux pages 271-272.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 279
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782336302621
- Date de parution :
- 10-12-14
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 160 mm x 240 mm
- Poids :
- 440 g
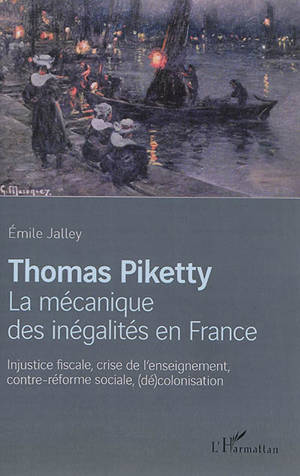
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.