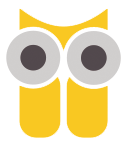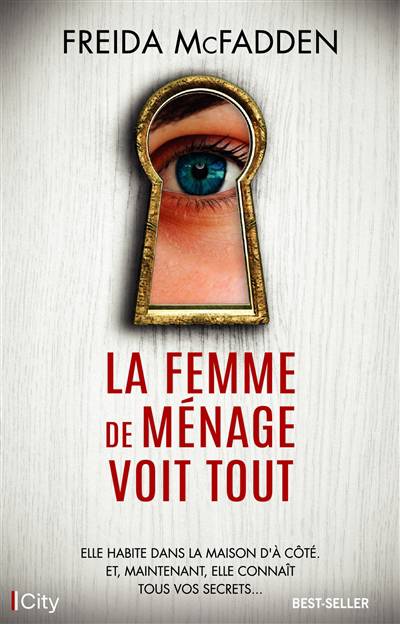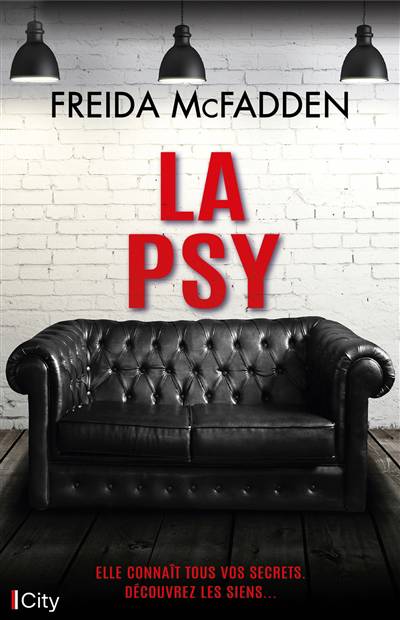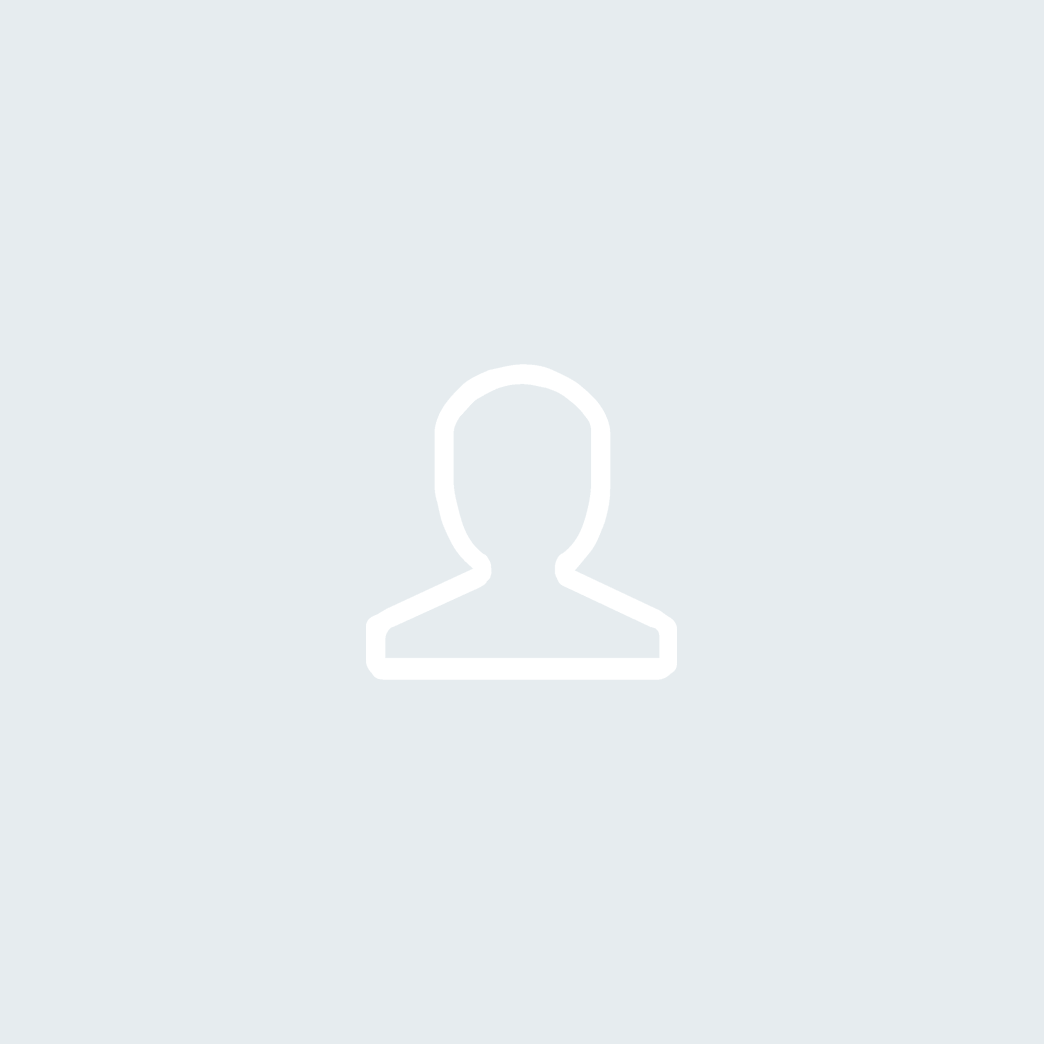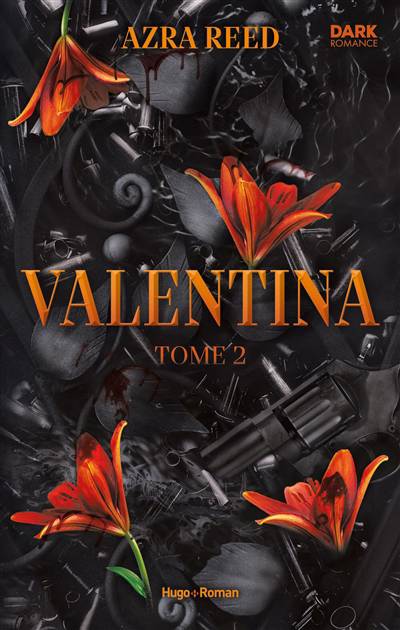
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
Lorsque je réfléchis aux conditions dans lesquelles j'ai pu participer à la recherche sur le monde soviétique avant sa chute, une cohérence dont je n'avais pas eu une perception très nette m'apparaît : de façon plus ou moins centrale se trouve posée la question des sources, de celles dont j'ai manqué, de celles qui m'ont aidée, de celles que j'ai construites. Dans ma pratique de chercheure comme dans ma pratique professionnelle, pour moi indissociables. Je n'ignore pas que l'exercice de reconstruction du passé, fût-il scientifique, n'échappe pas à l'« illusion biographique », mais je crois pouvoir relier cette cohérence à mon insertion dans une institution (la BDIC) spécialisée en histoire contemporaine qui m'a formée à la gestion des documents et m'a permis d'en produire. Qu'il s'agisse des archives orales et filmiques, tardivement prises en compte par les historiens, de l'accès, non sans peine, aux archives des États ex-communistes comme des autres, ou encore des progrès de la numérisation, les sources se sont démultipliées depuis peu. Bénéficiant d'un poste privilégié, j'ai pu observer ce moment charnière du « tournant électronique » de la documentation, évocateur d'un autre tournant dans la discipline historique, qui nous encourage à penser ses effets de connaissance sur l'écriture de l'histoire.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 270
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782859447595
- Date de parution :
- 24-10-13
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 130 mm x 220 mm
- Poids :
- 364 g

Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.