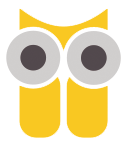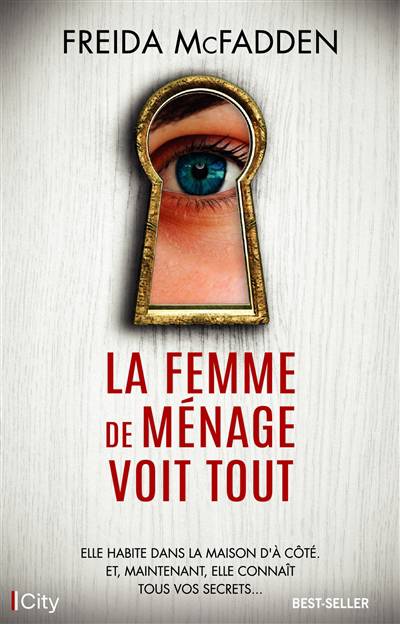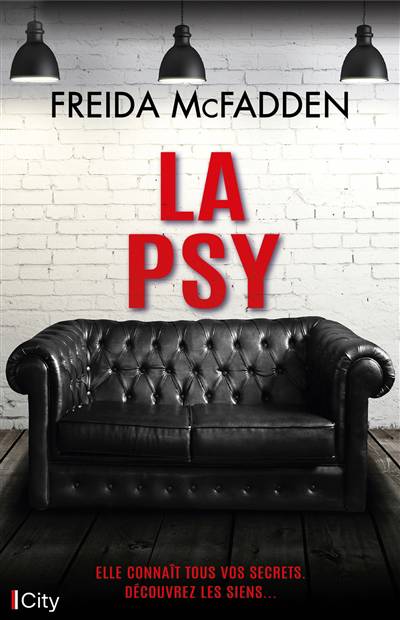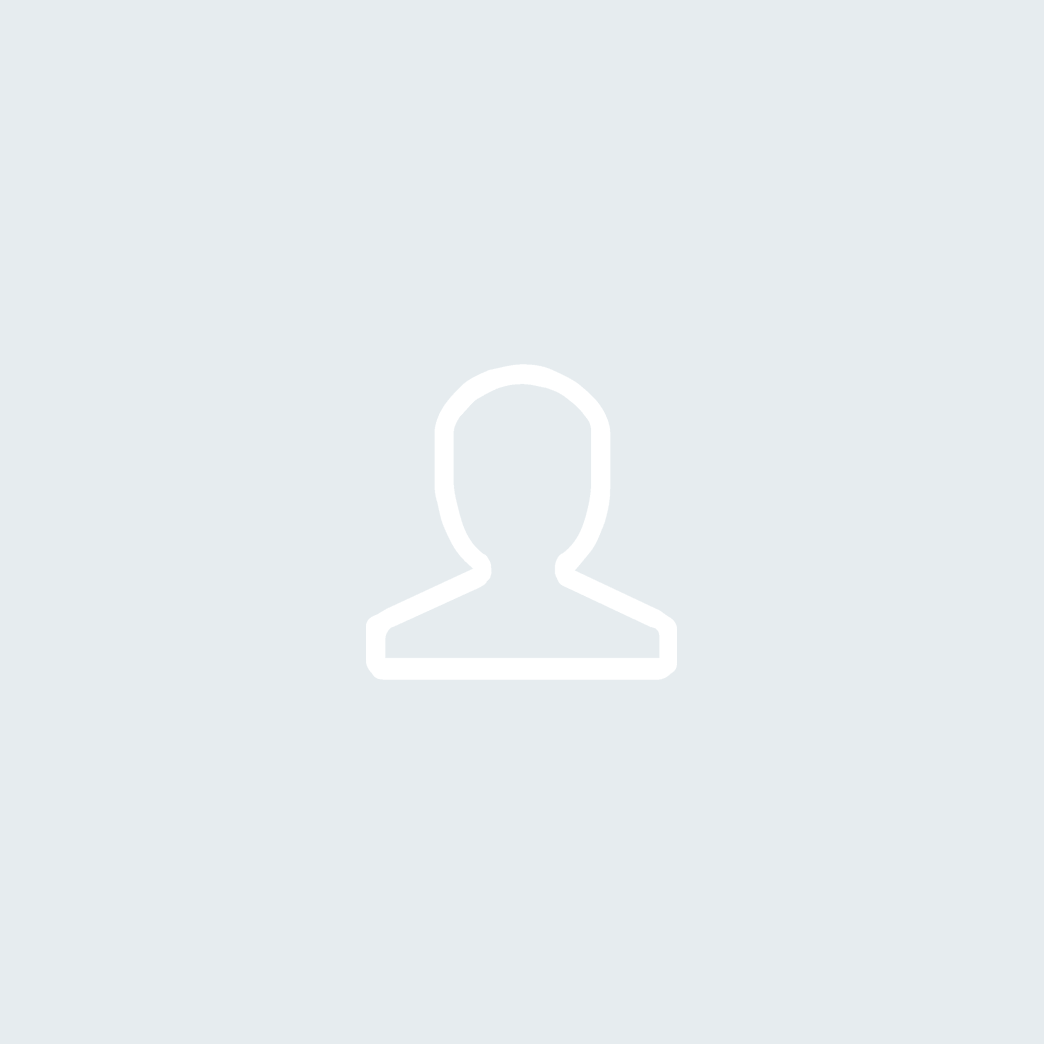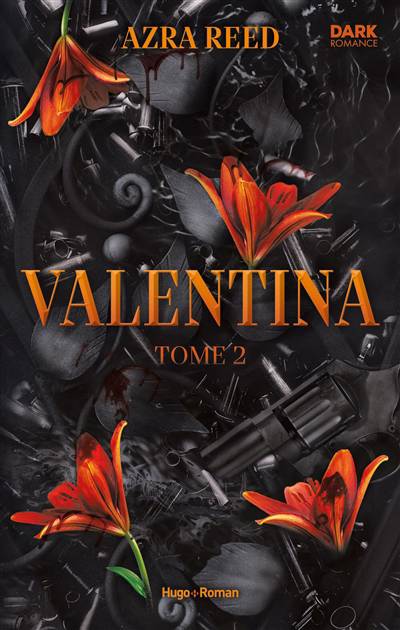
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
Dans les années 1571-1572, au deuxième étage d'une tour panoptique,
Montaigne transforme une «garderobe» en «librairie», flanquée d'un
«cabinet» : ici, des peintures murales à l'antique ; là, des sentences ou
maximes tracées sur des poutres, en grec et en latin. Un espace consacré
à l'amitié et surtout à soi-même, où le gentilhomme s'est rêvé très
romain et un peu grec, puis révélé écrivain francophone.
La découverte de ce lieu d'exception a une histoire, liée à celle du
tourisme et à celle du regard. Il fallait d'abord raconter cette histoire
curieuse d'un apprentissage de la vue. L'observation in situ est une
autre exigence : on lui doit une belle moisson de dix sentences inédites,
présentes dans la couche inférieure de solives palimpsestes (donc
soixante-cinq sentences pour l'édition critique, outre deux inscriptions
murales et une dédicace de la bibliothèque à La Boétie). La recherche
s'effectue alors en amont (sources textuelles, modèles graphiques et
traditions décoratives) et en aval (innutrition des Essais de 1580 par le
paratexte toujours offert des sentences peintes). Un constat : au plafond
(surmoi ?) comme dans le livre (II, 12), voix sceptique et versets
bibliques s'entendent à condamner le penser orgueilleux, avide de
science vaine et ennemi de la grâce, comme de la santé.
Mais comment se bien placer dans ce theatrum de la vanité des sciences,
où l'architectonique a commandé en partie la disposition des inscriptions
? Faut-il être assis, debout, mobile ? Regarder devant soi, au-dessus
de soi, ou bien «de bon biais», «d'une vue oblique» ? Le mieux est de
tout essayer : dans tous les cas, on aura sans doute appris, le corps aidant,
à mieux lire les Essais, ce livre unique qui eut la tour de Montaigne pour
berceau.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 548
- Langue:
- Français
- Collection :
- Tome:
- n° 1
Caractéristiques
- EAN:
- 9782252033173
- Date de parution :
- 18-12-00
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 150 mm x 220 mm
- Poids :
- 798 g

Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.