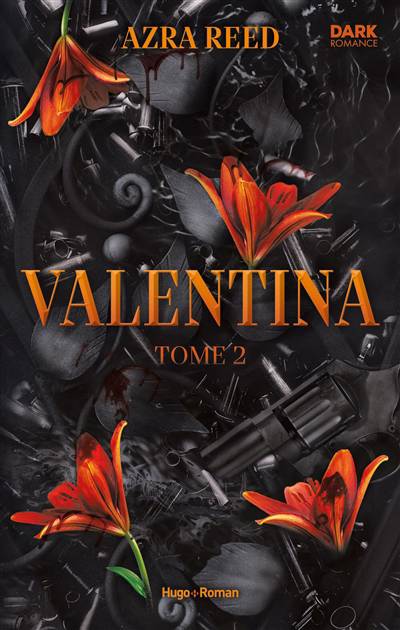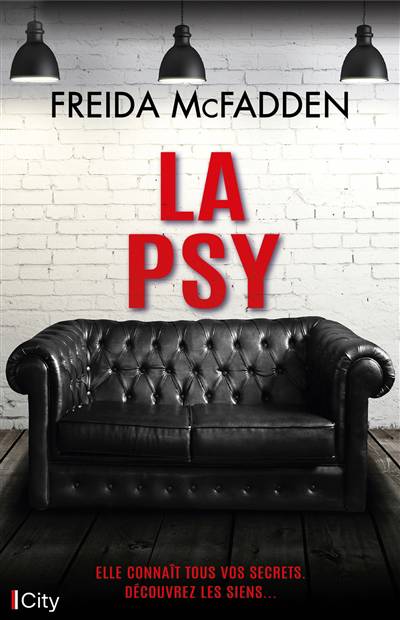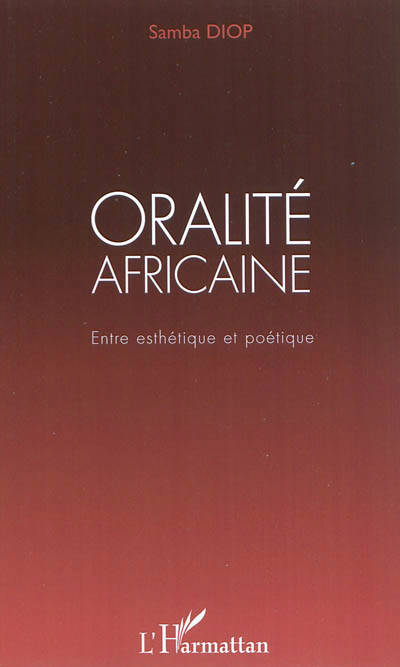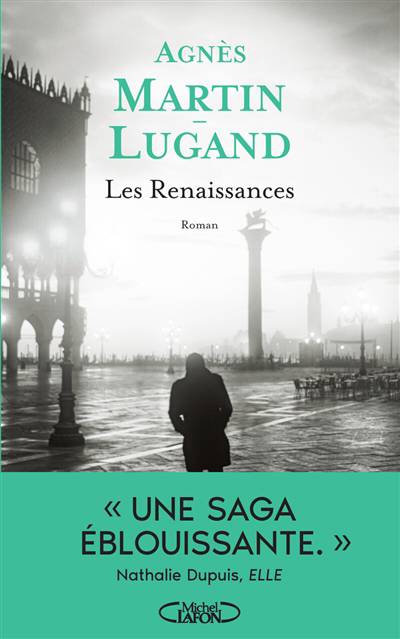
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
Comment percevoir l'oralité africaine face à la dictature de l'écriture ?
Difficile et périlleux exercice auquel se livre l'auteur, au gré des courants
d'air qui s'engouffrent dans les oreilles restées vigilantes. Sans le rituel
du transfert vers l'ouïe, y compris le silence qui atteint l'oreille, l'oralité
n'existerait pas. La civilisation africaine non plus d'ailleurs ! L'esthétique
de l'oralité ressemble alors fort à une forme postmoderne de la poétique de
l'écriture. L'oralité devient, de ce fait, non plus la traduction de l'absence
de l'écriture mais bien une transfusion des réalités renouvelées du passé,
des aïeux vers les générations d'aujourd'hui et du futur. L'oralité se mute
ainsi en musique et en silence rythmés.
Il n'est alors pas étonnant que les genres littéraires qui émergent de
l'oralité africaine naviguent furtivement entre mythe, conte, épopée,
généalogie, roman, poésie, musique et silence. Il ne s'agit pas uniquement
de tradition mais bien de la nouvelle alliance entre le passé et le futur,
l'imaginaire des civilisations et cultures africaines. La survie de la tradition
dans un contexte de modernité pose le problème même de la survie de la
modernité face à la tradition. Tout se joue dans la transmission. Alors,
l'Internet, créateur de choc des civilisations virtuelles, ouvre les portes
d'une nouvelle richesse de la perception.
C'est cette pluralité simultanée que Samba Diop tente de transmettre,
lui le troubadour de l'oralité.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 186
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782296559417
- Date de parution :
- 30-12-11
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 140 mm x 220 mm
- Poids :
- 245 g
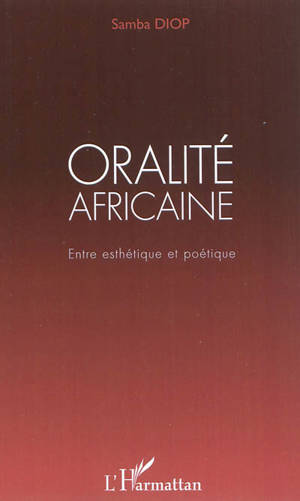
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.