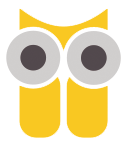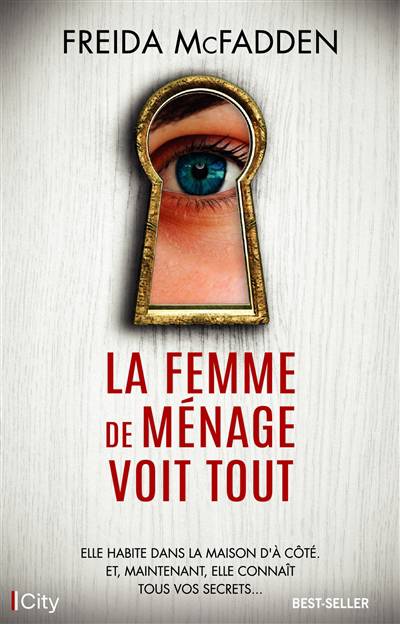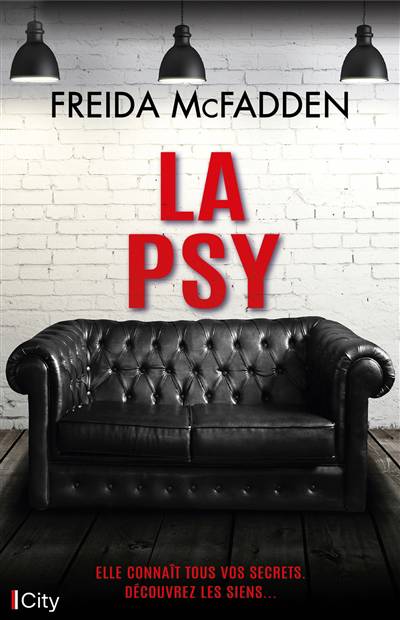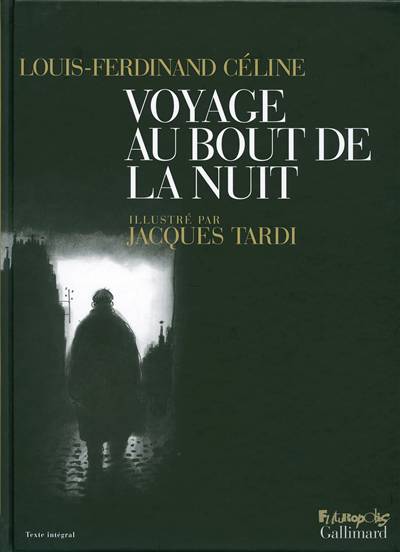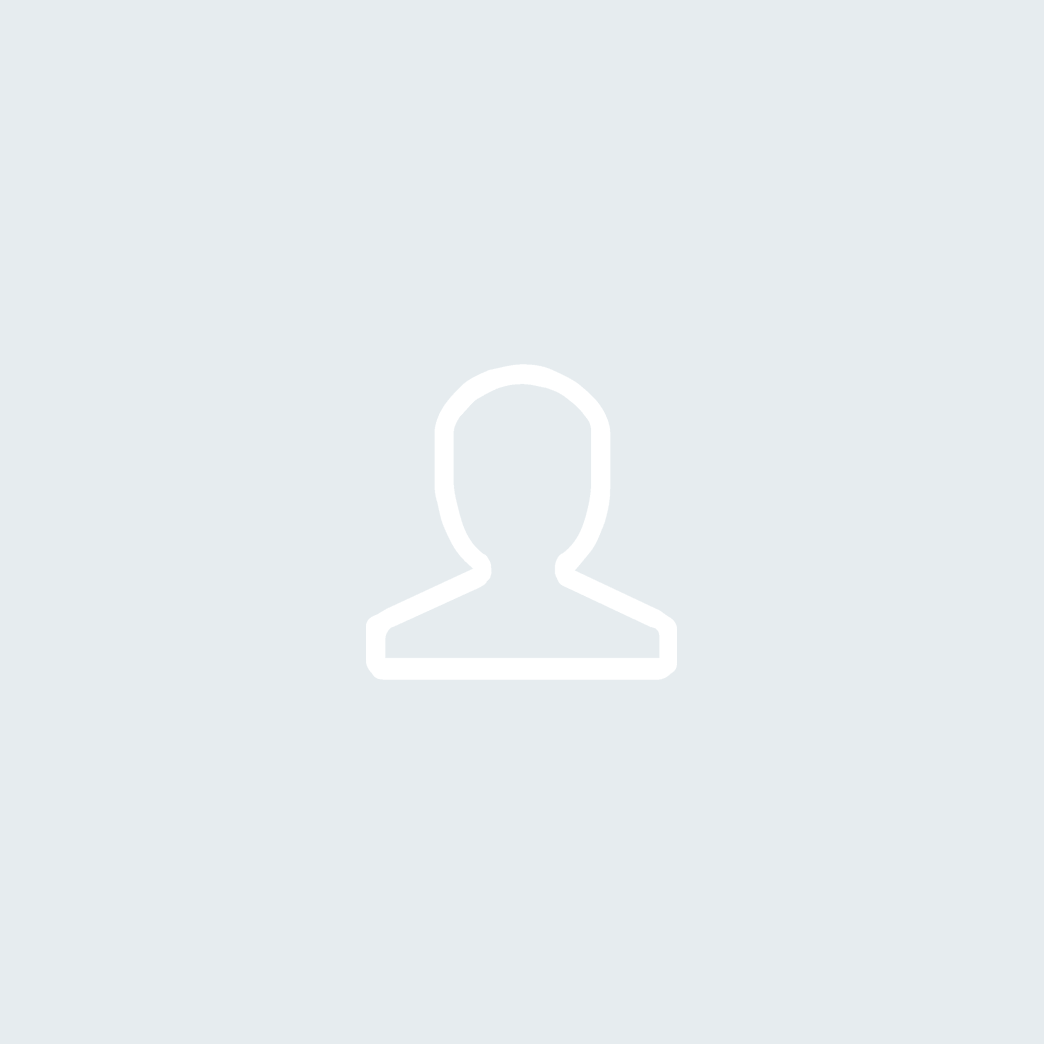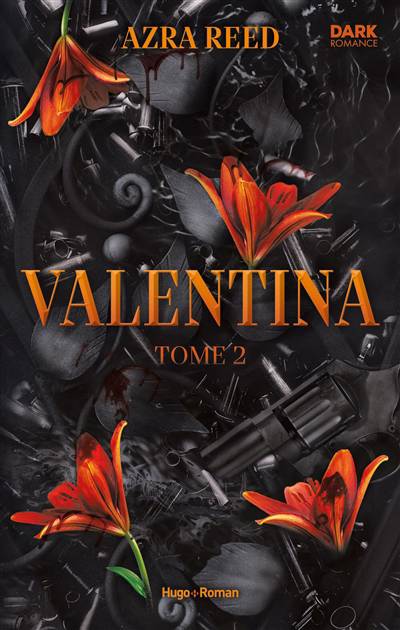
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Description
Peu de livres ont une aussi
grande puissance de vision que
Voyage au bout de la nuit.
Vision intense : celle de la révélation
de la misère, de la guerre, de
la maladie sans fin, de la mort. La
phrase se concentre, repère tout,
ne pardonne rien. Vision itinérante
et prodigieusement variée ensuite :
on part de la place Clichy, on se
retrouve dans divers massacres à
cheval, puis dans une Afrique
écrasante, puis noyé à New York,
à Detroit, puis de nouveau dans
la banlieue de Paris (la banlieue
de Céline, cercle minutieux de
l'enfer !), puis dans les environs
de Toulouse, et enfin dans un asile
psychiatrique pas comme les
autres. La mort au départ et à
l'arrivée. La symphonie agitée de
la nuit infinie pour rien.
Le héros métaphysique de
Céline est ce petit homme
toujours en route, entre Chaplin
et Kafka mais plus coriace qu'eux,
vous le redécouvrez ici, perplexe,
rusé, perdu, ahuri, agressé de
partout, bien réveillé quand
même, vérifiant sans cesse
l'absurdité, la bêtise, la méchanceté
universelles dans un monde
de cauchemar terrible et drôle.
Céline lui-même a comparé son
style aux bandes dessinées, aux
«comics». C'était pour dire qu'il
allait toujours au vif du sujet, au
nerf de la moindre aventure. Ce
Tardi-Céline l'aurait ravi.
L'oeil traverse le récit comme
une plume hallucinée, on voit
le déplacement sans espoir mais
plus fort, dans son rythme de
mots et d'images, que tout désespoir.
Il faut relire Céline en le
voyant. Tardi lui rouvre l'espace.
Le grouillement et la simplicité
des épisodes et du jugement qu'il
porte se redéploient.
Céline a dit la vérité du siècle :
ce qui est là est là, irréfutable,
débile, monstrueux, rarement
dansant ou vivable.
Le Voyage recommence.
Les éclairs dans la nuit aussi.
Philippe Sollers
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 379
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782754800921
- Date de parution :
- 23-11-06
- Format:
- Livre relié
- Dimensions :
- 220 mm x 300 mm
- Poids :
- 1826 g
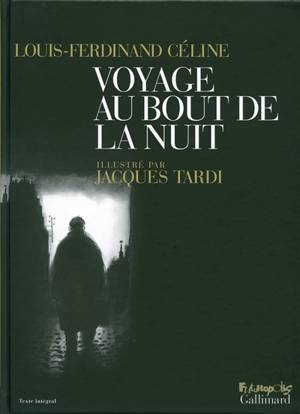
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.